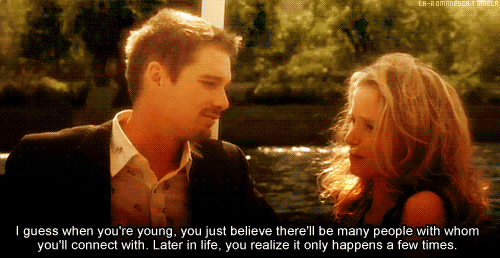La poudre de Berlinpinpin
Les nuits berlinoises sont réputées pour leur liberté et leur clubbing à nul autre pareil. Mais la magie de la fête n’est pas seulement due à la bonne humeur ou à l’abus de shots de Jägermeister. La cocaïne est presque devenue un produit de grande consommation dans la capitale de la nuit européenne. Sans jugement ni condamnation, lettre ouverte d’une fêtarde patentée à ses amis cocaïnomanes
Dans les commentaires de mon dernier article, un lecteur me taxait d’angélisme, car je ne faisais pas mention de la coke qui circule dans les toilettes du club Berghain. Bien que je comprenne son étonnement, mon propos n’était pas de raconter ces douze heures passées dans l’antre de la techno sous l’angle de la drogue – elle n’est qu’un aspect de la fête, pas l’essence. Le sujet délicat de la consommation de cocaïne à Berlin mérite qu’on prenne des pincettes.
Et pourtant, me direz-vous, vous qui habitez à Berlin depuis un mois ou trois ans, vous qui sortez et fréquentez les boîtes, la coke, c’est la petite poudre de la fiesta, rien de bien grave. Pas d’addiction, dit-on. Son prix a d’ailleurs baissé radicalement ces dernières années – et sa qualité aussi.
A quoi est-elle coupée ? Au bicarbonate de soude, aux amphétamines. Assemblée dans des appartements berlinois par de petits dealers solitaires, elle se déverse dans les rues de la ville comme une pluie d’argent, livrée à la seconde par des mecs en bagnole qui bossent comme vendeurs de kebab le jour. C’est ça, la vie du dealer de c à Berlin : une existence de merde, une existence traquée par les flics, une vie d’esclave qui attend toujours un coup de fil ou un SMS. La plupart d’entre eux sont Turcs et ne boivent même pas d’alcool. Avec raison, ils méprisent leurs clients, car ils savent bien ce qu’il y a dans la poudre qu’ils leur vendent. De la merde.
J’ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés hystériques nus,
se traînant à l’aube dans les rues nègres à la recherche d’une furieuse piqûre…
… écrivait le poète américain Allen Ginsberg dans Howl en 1955. Pour l’imiter, je dirais que je vois les artistes les plus fins perdre toute inspiration dans des nuits futiles. Je vois des gentlemen se transformer en d’arrogants connards sûrs de leur séduction boostée à la poudre blanche. Je vois des filles gracieuses et pleines d’esprit perdre l’appétit – d’abord pour la bouffe, plus tard pour la vie. Je vois des intellectuels ramper devant certains dealers machistes et sans éducation. Je les vois lécher les bottes d’un abruti dispensant sa poudre de perlimpinpin dans les soirées pour faire le coq. J’entends des propos messianiques, des discours pompeux, déclamés dans des gogues sombres et sales. La marijuana rend vaseux, la mdma rend nympho, l’ecstasy rend hystérique, le LSD rend mystique. La coke, elle, rend con, prétentieux et lâche.
Mes amis – je ne veux plus vous voir ainsi. Je ne veux plus te voir, toi le photographe doué de tant de talents, perdre tes nuits dans cette quête contre ta solitude rampante, je ne veux plus voir tes doigts trembler en appuyant sur le déclencheur parce que tu as passé la nuit précédente à te défoncer le cerveau. D’ailleurs, tu ne parles plus que de ça. De la coke. Tes conversations sont devenues stériles et chiantes, toi qui me faisais rire comme personne.
Je ne veux plus te voir, toi le DJ aimé de tous, à l’aube d’une carrière florissante, rater un set pour une trace de trop. Je ne veux plus te voir tromper ta petite amie avec une pouffe de groupie juste parce que tu étais défoncé.
Je ne veux plus te voir, toi l’étudiant si charmant, rater la manifestation que tu as organisée toi-même, parce que tu es au fond de ton lit, digérant les deux grammes que tu t’es pris hier.
Je ne veux plus te voir, toi le jeune patron de bar, toi le Turc qui est beau comme un astre, qui t’es fait tout seul, qui passait des plats à douze ans dans le resto de ton oncle et qui désormais règne sur un coin de la nuit berlinoise, toi, mon bel ami, devenir muet à force de drogue, sinistre et sombre, incapable d’aimer une femme.
Et toi l’homme que j’ai aimé, je ne te verrai plus prendre tes traces à six heures du matin dans ce lit que nous partagions, ou dans les backstages après ton concert que tu avais raté parce que la drogue t’avait rendu froid comme le marbre, parce qu’elle avait raidi tes doigts sur ta guitare, qu’elle avait glacé ton regard et que le public ne pouvait pas entrer en communion avec toi. Toi que j’avais rencontré griffonnant des poèmes à toute heure du jour et de la nuit, toi qui découvrait l’Europe avec émerveillement, tu ne sortais plus de ton lit. Nos jours ressemblaient à nos nuits. Non, mon amour, ce n’est pas cela le rock, ce n’est pas cela, la musique, ce n’est pas cela, l’attitude.
Mes amis. La coke vous donne le sourire une heure et puis vous l’ôte des jours entiers. Elle vous envoie au paradis de l’ego pour quinze minutes puis vous plonge dans l’enfer de la veulerie, avant de vous jeter dans des oubliettes de tristesse et de solitude. On appelle ça la descente. Certains la subissent plusieurs jours de suite. D’autres sont tellement accros qu’ils ne la sentent plus, la descente. Leur état normal, c’est le high.
Mes amis, ne me dites pas qu’il n’y a pas d’addiction avec la cocaïne. Ne me dites pas ça, pas à moi. Qui a inventé ce mensonge? Et toi qui me lis, si tu n’as jamais commencé, sois un freak. Refuse. Tous les artistes de la nuit que je connais à Berlin et qui continuent de travailler ont arrêté. Et oui, je vous le dis : la nuit se vit bien mieux sans cette saloperie. Elle se vit aussi très bien sans cigarette, j’en suis la preuve vivante (et même sans alcool, mais ne me demandez pas de lâcher mon verre de blanc, il me faut bien une drogue à moi aussi). Tout ça, c’est du bullshit. Qui fabrique ces produits? Qui les vend? Pensez à ça. Est-ce que cela correspond à vos idées politiques? Sociales? Réfléchissez à ça, mes amis.
Non, je ne vous juge pas, mes pauvres amis cocaïnomanes, qui êtes tellement persuadés que vous « gérez ». Droguez-vous si le coeur vous en dit, mais sans moi. Par amour, je ne vous verrai plus. Vous ne gérez pas du tout. Je ne peux plus vous voir vous détruire. L’un d’entre vous est mort en Italie récemment. Dans un accident de voiture. Il était high, complètement high. Il croyait, avec son ego pompé à mort par la poudre, qu’il allait « gérer ».
Depuis quelques temps, je suis le blog de Juliette F., une mystérieuse jeune Parisienne qui, accro à 19 ans, vient tout juste de s’en sortir, des années plus tard. Ses récits sont superbes, gracieux, émouvants. Elle donne même des conseils pour arrêter. Elle parle de cette drogue comme il le faut : cette chose séduisante, cette chose tellement à la mode, à laquelle on ne pense jamais qu’on est addict, tout en l’étant – à mort. Juliette F. est une lumière dans le paysage de la nuit.
Être sobre c’est être in. Comme les punks de la première génération. Straight attitude. Gardons la tête sur les épaules, l’esprit clair. On en a besoin dans ce monde d’espionnage digital, de fausse liberté, de fausse démocratie. Straight attitude, encore et encore!