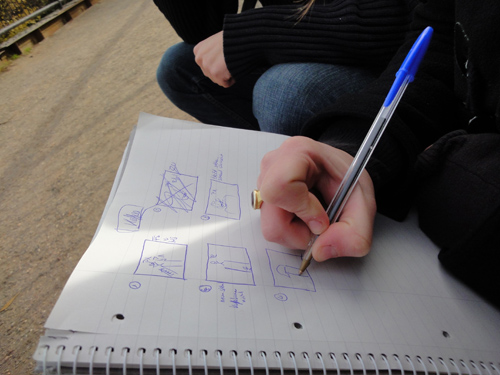Oui, il y a une économie à Berlin !
Diana Durdic, cofondatrice de Sing Blackbird, un concept économique original
C’est bien connu, à Berlin, il n’y a pas d’industrie. La capitale allemande traîne sa réputation de métropole de la culture et de la fête, bourrée de chômeurs et d’étudiants sans le sou. Pourtant, je constate, au fil de mes promenades et de mes rencontres, que des bars, des galeries et des boutiques fleurissent à tous les coins de rue. Y aurait-il donc une économie à Berlin, un marché?
C’est ce que soutient Diana Durdic, 30 ans, fille de travailleurs immigrés croates installés à Karlsruhe en 1972. Elle vit à Berlin depuis cinq ans. „Berlin m’a changée, dit-elle. Dans le Sud-Ouest de l’Allemagne, là d’où je viens, on ne pense qu’à faire de l’argent. A Berlin, il n’y a pas cette pression.“ Et la Croatie? „Depuis la guerre, le dernier lien avec le pays a été rompu“, explique Diana.
Diana est copropriétaire du café-magasin de mode vintage Sing Blackbird à Berlin, et elle en connaît un rayon question carrière, bénéfices, marges et bonus. Elle a passé presque cinq années dans une agence de pub et y gagnait très bien sa vie, mais y était aussi „très malheureuse“, souligne-t-elle. Refusant d’être „esclave de cette société de vie de bureau“, elle a claqué la porte pour monter son affaire en 2010 avec sa collaboratrice américaine Tasha Arana. Et… ça marche!
„On a ouvert il y a peu, mais on fait déjà des bénéfices!“ dit Diana en riant. „La crise, la crise, la crise, on n’entend parler que de la crise. Pourtant, les gens, à Berlin, achètent toujours des fringues et boivent toujours du café! Ils épargnent plutôt sur les gros achats. On vend des vêtements d’occasion uniques, àprix très raisonnables“, raconte Diana.

Ici, les pancakes ne viennent pas du supermarché…
Mais la grande originalité du concept de Sing Blackbird, c’est son système de troc : les clientes peuvent échanger leurs vêtements contre l’une des merveilleuses pièces chinées par Diana et Tasha. C’est là toute la philosophie de ces jeunes entrepreneuses modernes : recycler, échanger, être son propre patron, faire une carrière respectueuse des autres et de l’environnement.
Chez Sing Blackbird, on mange également des scones et des pancakes bios, faits maison, selon des recettes inédites, comme le cheesecake à la citrouille. Le café (exquis) est produit par un torréfacteur de Berlin, et son prix est raisonnable. „Nous voulons soutenir une économie régionale“, appuie Diana en me servant un latte macchiato, ce lait chaud additionné d’un simple trait de café, si à la mode dans la capitale allemande.
„La liberté n’est pas libre, dit-on en allemand“, s’exclame Diana. „Être entrepreneur, c’est la liberté de faire soi-même, mais cela enferme dans une très grande responsabilité“. Diana et Tasha travaillent six jours par semaine et doivent constamment renouveler leurs idées et réorganiser leur travail.
„Il faut toujours retravailler ses objectifs de la manière la plus efficace possible“, explique Diana. „A terme, on veut avoir des employés. La nature humaine veut que l’on cherche à faire toujours plus de fric et à en dépenser moins. Pour moi, cela ne sert qu’à rendre malheureux. Notre entreprise doit grandir, oui, mais raisonnablement. »
Créer de l’emploi et monter son petit business ne serait donc pas une affaire impossible à Berlin. De quoi donner des idées à tous les jeunes chômeurs d’Europe et autres étudiants saturés de stages non-payés, non? Quant à moi, j’ai déjà fait mon petit baluchon de vêtements à troquer, et je me demande lequel des merveilleux gâteaux de Diana je vais bien pouvoir goûter la prochaine fois…
Sing Blackbird, Sanderstrasse 11 12047 Berlin