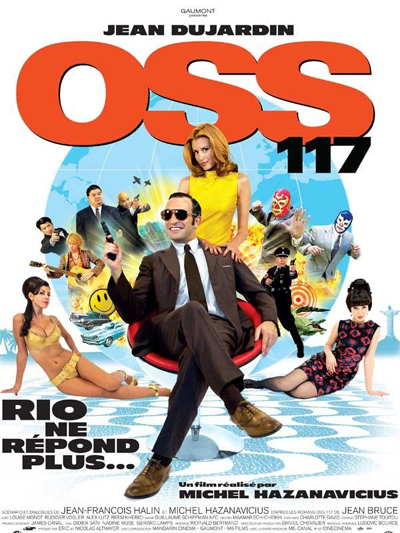Le tueur du quartier rôde à Berlin
Bonnet en laine même en été, énorme casque audio, chai latte to-go, MacBook sur l’épaule, Iphone et baskets importées des US : il est trop cool, le Kiezkiller berlinois – le « tueur de quartier », en français. Ce nouveau type humain est réputé pour briser les vies de quartier tranquilles, résidentielles et populaires en introduisant le capitalisme bobo dans la ville. Faut-il le lyncher?
Oui et non. Car lyncher le Kiezkiller, c’est se lyncher un peu soi-même. Le Kiezkiller s’est glissé partout à Berlin et, comme le souligne cette affiche, tu es peut-être, toi aussi, un tueur de quartier sans même t’en rendre compte (« Bist du auch ein Kiezkiller? » « Es-tu aussi un tueur de quartier? »).
Le phénomène est très flagrant à Neukölln. Neukölln, c’est un quartier relativement excentré de Berlin, paumé sur le Ring (l’équivalent du périph parisien). Il y a encore deux ans, habiter à Neukölln, c’était faire son trou dans celui du cul du monde. Aujourd’hui, c’est hype. Pourquoi?
Dans ce quartier populaire peuplé de vieux Berlinois réputés pour leur style hérisson – me fais pas chier, laisse-moi boire ma bière – et d’immigrés Turcs, qui subissent de la part des premiers un racisme désagréable, une colonie de jeunes artistes et d’étudiants a commencé à faire son nid. Les loyers de Neukölln, incroyablement abordables pour une capitale européenne (environ 500 euros pour un 100 mètres carrés) ont attiré de nombreux jeunes amateurs de bohème des quatre coins de l’Europe et des États-Unis. Des peintres et des sculpteurs de 25 ans ont trouvé, dans des ateliers à 150 euros par mois, l’espace et la tranquillité qui leur faisaient défaut ailleurs.
Et voilà que les étudiants grandissent et se mettent à ouvrir des bars pour leurs petits camarades. Dans la Wesertrasse, encore artère morte de Neukölln fin 2008, des repaires branchés ont poussé comme des champignons pendant l’été 2009. Le Tier, le Ä, le Ratzepuntz, Feast et j’en passe, régalent les amoureux de techno, de concerts rock, de bière et de vin bios, et surtout de jeunes femmes et jeunes gens hyperlookés à coup de fripes sexy (cf. mes copines de fringues vintage à Neukölln dans cet article.)
Dans la Weserstrasse, les jeunes branchés du « Ä » regardent les projections sur le mur du « Tier », en face.
Évidemment, le visage de Neukölln en est changé. Les artistes et les étudiants arrivés au tout début de la boboïsation se plaignent de voir arriver leurs clones dans leurs pénates. Ces branchés en terrasses, ces nouveaux Kiezkiller, ils énervent, avec leur latte macchiato, leurs gros écouteurs d’Ipod blancs de chez Bose et leur MacBook arborant des autocollants qui proclament la révolution.
Ça énerve, mais c’est cela, le destin d’un quartier. Rien ne sert, à mon avis, de vouloir conserver dans du chloroforme des modes de vie pour la simple raison qu’ils ont « été » un jour ainsi. Que je sache, les vieux habitants de Neukölln et les communautés turques ne sont pas menacées comme une espèce animale en voie d’extinction par les « Kiezkiller ».
Non. Les vrais fautifs, ce sont toujours les mêmes. Ceux qui, profitant du look plus agréable de Neukölln, rachètent à tour de bras des immeubles, les rénovent (hideusement) à grand coup de peinture jaune soleil et louent les appartements à des prix largement supérieurs à ceux de 2008. L’aseptisation est toujours le fruit de la spéculation. Les bobos n’en sont que les consommateurs.
Ne lynchons pas le Kiezkiller. Apprenons-lui à refuser de payer son loyer trop cher et à manger des saucisses ou des börek avec ses voisins.