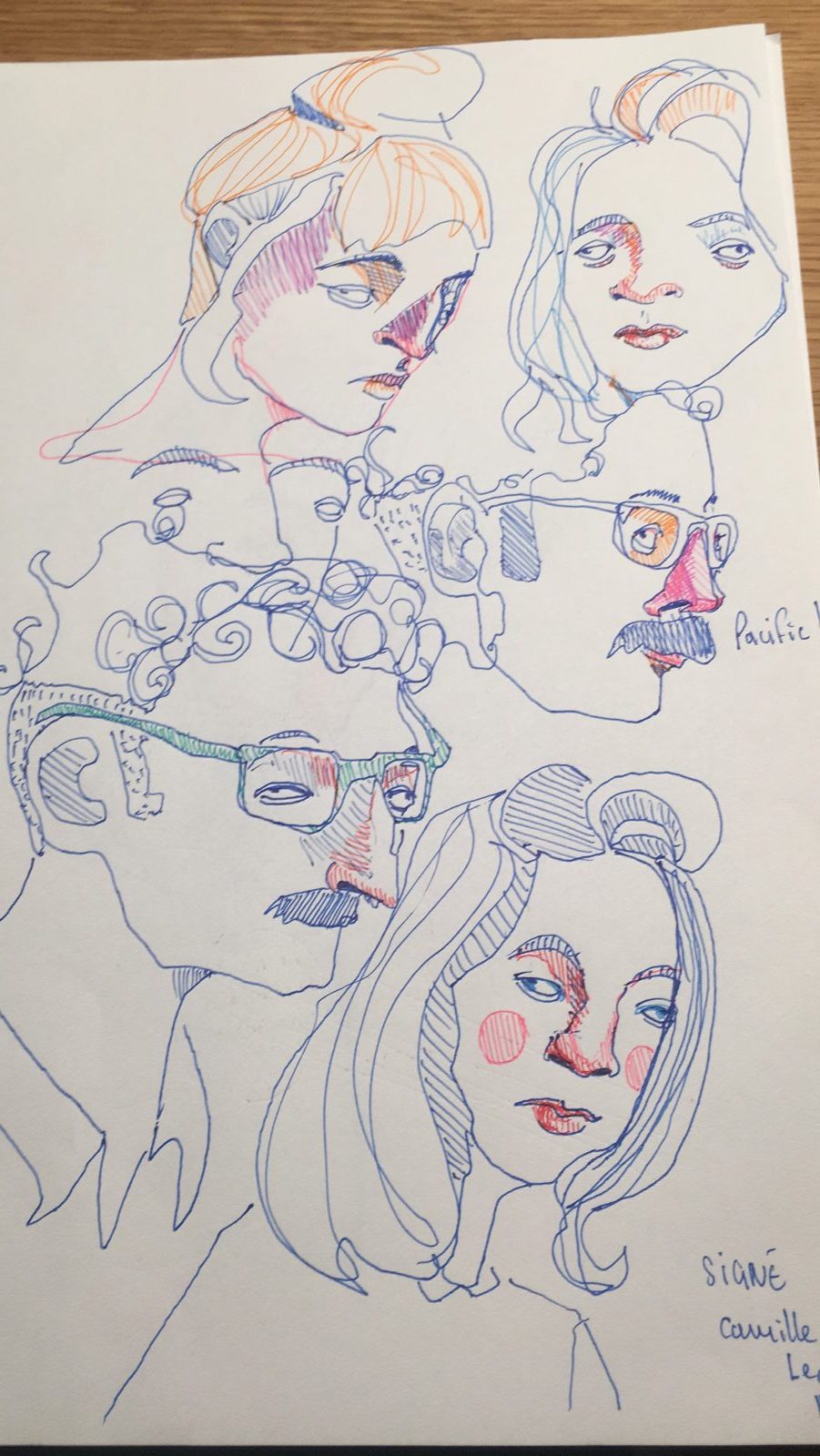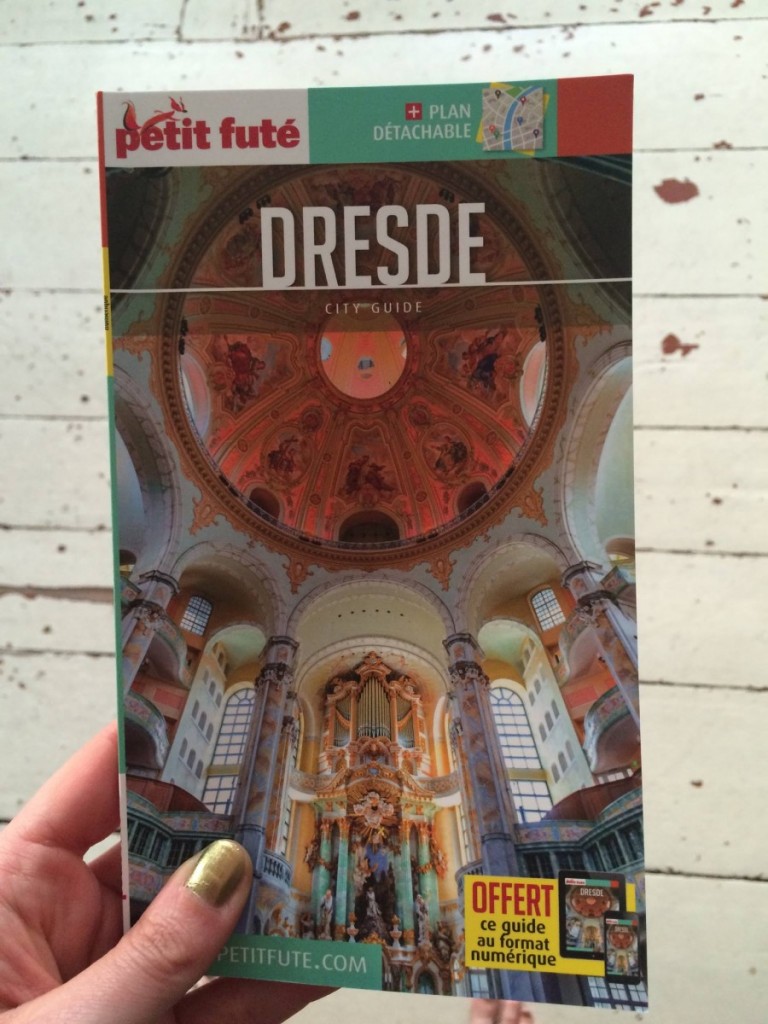I am Europe, Berlin est l’Europe
Hier, je suis allée voir I am Europe, spectacle du le metteur en scène allemand Falk Richter avec huit performeurs et performeuses européens, à l’Odéon – Théâtre de l’Europe à Paris. Courageuse, rentre-dedans et passionnée, cette pièce co-écrite avec ses actrices et ses acteurs est une ode à la grande idée européenne. Et si une ville au monde incarne, pour moi, mieux qu’aucune autre cette idée-là, c’est bien Berlin.
Ils sont croates, portugais, français, italiens, allemands, belges… Ils sont surtout de véritables bâtard.e.s européens, heureux mélanges transalpins, nordiques, régionaux, de toutes confessions et de toutes orientations sexuelles. Ce sont les actrices et les acteurs recrutés par Falk Richter, qui sont d’ailleurs bien plus que cela : danseur.se.s, chanteur.ses.s, auteur.e.s voire metteur.se.s en scène, ils déploient leurs talents aux quatre coins de la scène extravagante que leur offre Richter.
Écrit par les performeur.se.s en collaboration avec Richter, le spectacle est un collage de paroles libres sur l’identité européenne. Il y a Charline Ben Larbi, métisse franco-marocaine, qui parle de son enfance passée à devoir baisser les yeux devant les bandes de filles de la cité qui ne voulaient pas l’accepter à cause de la blancheur de sa peau. Il y a Khadija El Kharaz Alami, hollandaise d’origine marocaine, qui refuse d’être le « passeport diversité » de son hilarant ami belge, Douglas Grauwels, lequel espère ainsi gratter quelques euros du Fonds pour la Diversité. Mehdi Djaadi, musulman converti au catholicisme qui parle de sa foi avec la verve d’un Paul Claudel. Gabriel Da Costa, queer déchiré au sujet des Gilets Jaunes. Lana Baric, Croate qui se considère d’abord comme Yougoslave, rejette le nationalisme et fait pleurer le public à chaudes larmes, avec son magnifique monologue sur la guerre des Balkans. Tatjana Pessoa, polyglotte aux multiples talents, lointaine nièce de Fernando Pessoa, qui va avoir un enfant avec Gabriel et son compagnon. Piersten Leirom, qui, dans une tirade à se tordre de rire, déclare son fantasme inavouable de se faire « punir » sexuellement par Mehdi dans une cave des cités.
Ils chantent, dansent, hurlent leurs craintes, murmurent leurs espoirs, s’aiment, s’engueulent, s’éclatent, rigolent, travaillent et boivent trop. Pour tout vous dire, j’avais l’impression d’être dans mon salon à Berlin. J’avais le sentiment que tous ces gens étaient mes copains, qu’ils étaient tout aussi bordéliques, mixtes, mélangés, sexuellement confus ou multiples que mes amis. Un bien joyeux bordel queer, coloré et féministe. Je n’étais d’ailleurs pas la seule à me reconnaître dans ce spectacle : après une véritable standing ovation, j’ai aperçu une classe de lycéens de toutes origines. Une jeune fille noire se tourne vers ses potes : « c’est l’histoire de ma vie ! » Une jeune Maghrébine embrasse sur la bouche sa petite amie blanche, elles n’ont pas seize ans : « j’ai adoré et je t’adore ».
Le spectacle de Richter appelle le public à se réveiller et à relever le défi de continuer à aimer et construire l’Europe. Il appelle à protéger cette union que nous avons su bâtir, la comparant à une nuée d’oiseaux migrateurs toujours capables d’aller dans la même direction en dépit de ses identités multiples. I am Europe nous enjoint à voter avec notre tête et avec notre cœur plutôt qu’avec nos craintes déraisonnables de l’étranger. Comme Berlin, I am Europe est le miroir amoureux d’une société transversale, complexe, compliquée, formidablement démocratique.
Pour moi, Berlin incarne parfaitement l’idéal européen. Creuset d’idées progressistes, c’est une ville qui a toujours accueilli toutes les races, toutes les orientations sexuelles, toutes les identités de genre – en dehors, bien sûr, du temps de l’infect Adolf. Nous avons la chance de vivre à Berlin, ou bien d’y aller souvent, en tous cas de l’aimer (si vous êtes en train de lire ce blog, c’est parce que vous êtes un amoureux de Berlin, n’est-ce pas ?). Protégeons ce que nous aimons. Protéger, c’est faire grandir, c’est défendre avec amour : fermer les frontières, empêcher la circulation des êtres et des idées n’est en rien de l’amour ni de la liberté.
En aimant Berlin, nous chérissons un idéal européen incroyablement précieux. Nous avons besoin d’espoir face aux horreurs engendrées par le néo-libéralisme. L’appauvrissement des classes moyennes, l’humiliation des classes populaires vont grandissants, suscitant xénophobie, haines de classe, racisme, sexisme et homophobie. Berlin a toujours été un village résistant encore et toujours à l’ennemi fasciste, de toutes ses forces. Faisons-en partie, avec fierté. La liberté ne rime pas seulement avec le sexe, les drogues et le Berghain ; la liberté rime d’abord avec l’amour et le respect de celui qui est différent de nous. Berlin, c’est d’abord ça, et l’Europe, c’est d’abord ça.
N’oublions pas de VOTER dans et pour l’Europe, la seule vraie mère patrie qu’il vaille la peine de défendre. Pensons multiple au lieu de penser unique.
Et merci, Herr Falk Richter, pour ce spectacle bouleversant et revigorant !